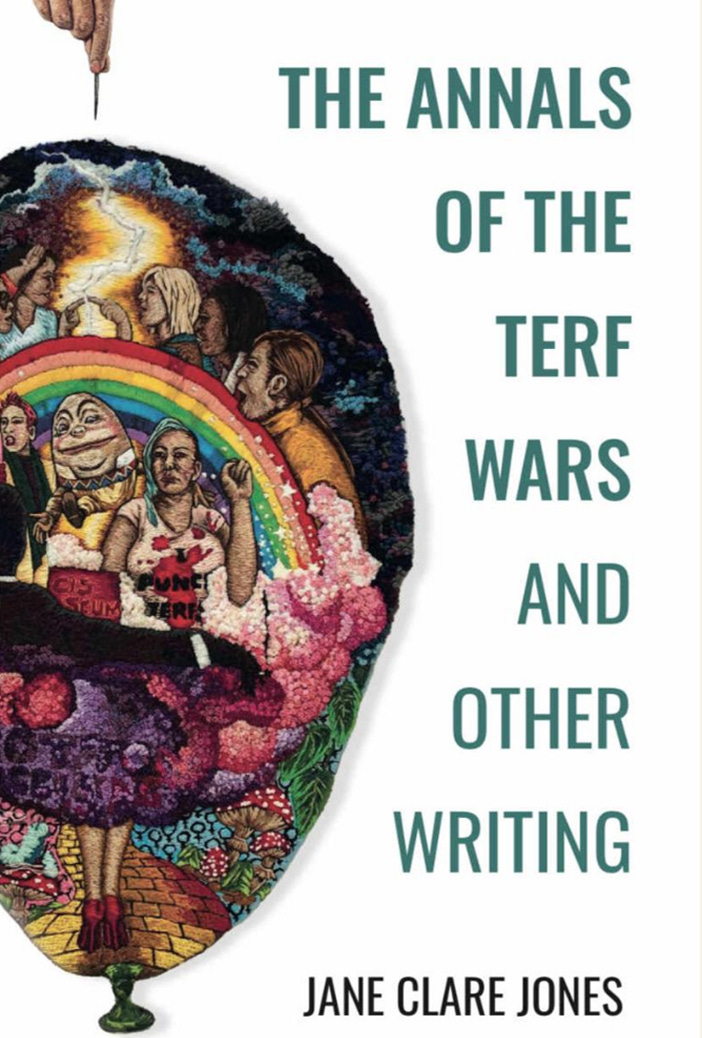Les hommes sont ce qu’ils disent être
Et les femmes sont ce que les hommes disent qu’elles sont
Jane Clare Jones est une philosophe féministe matérialiste de gauche. Elle analyse sans complaisance le dernier avatar de la conscience patriarcale que nous affrontons sous les traits du mouvement trans et montre dans une série de raisonnements édifiants que ce mouvement n’est autre qu’une application, sous stéroïdes, de la logique dominante du viol à l’œuvre depuis des millénaires dans les sociétés patriarcales.
« Il s’agit d’un conflit direct entre les désirs des hommes et l’existence des femmes, et il s’avère que nous vivons dans un monde où nous vaquons à nos affaires sans y penser comme si le désir masculin devait toujours l’emporter. »
Je vous présente aujourd’hui la traduction commentée et circonstanciée d’une conférence qu’elle a tenue devant l’Union Féministe d’Oxford en octobre 2021 et publiée dans son livre The Annals of the TERF Wars and Other writing (« Les annales des guerres TERF et autres écrits »)
Le pouvoir masculin de nommer
Discours prononcé devant l’Union Féministe d’Oxford
Bonsoir. Je suis très honorée d’être ici parmi ces femmes extraordinaires, et je voudrais remercier l’Union Féministe d’Oxford d’avoir organisé cet événement, et dire à quel point je suis heureuse de voir des féministes revendiquer leurs espace, leurs droits et discuter de l’existence et des intérêts des femmes. Ce qui m’amène à ce dont j’aimerais parler. Le thème de l’événement de ce soir est « Les mots et les actes », et j’aimerais réfléchir à ce qui est réellement en jeu dans la lutte pour le mot « femme », et à ce que cette lutte nous apprend sur les mécanismes fondamentaux du pouvoir patriarcal.
Pour commencer, je vais lire un extrait important du livre Pornographie, publié en 1979 par l’incomparable Andrea Dworkin, puis je vais décortiquer et réfléchir à la manière dont ses observations s’appliquent à notre situation actuelle. Cet extrait légèrement abrégé est tiré du premier chapitre du livre, dans lequel Dworkin expose son analyse des « principes de l’idéologie de la suprématie masculine » :
Les hommes ont le pouvoir de nommer, un pouvoir grand et sublime. Ce pouvoir de nommer permet aux hommes de définir l’expérience, d’articuler les frontières et les valeurs, de désigner à chaque chose son domaine et ses qualités, de déterminer ce qui peut et ne peut pas être exprimé, de contrôler la perception elle-même. Comme l’écrit Mary Daly, qui a été la première à isoler ce pouvoir, dans Beyond God the Father (« Au delà de Dieu le Père »): « il est nécessaire de saisir le fait fondamental que les femmes se sont fait voler le pouvoir de nommer »… Les hommes ont défini les paramètres de chaque sujet. Tous les arguments féministes… sont avec ou contre des affirmations… implicites dans le système masculin, qui sont rendues crédibles… par le pouvoir des hommes de nommer. Aucune transcendance du système masculin n’est possible tant que les hommes ont le pouvoir de nommer… Comme Prométhée a volé le feu aux dieux, les féministes devront voler le pouvoir de nommer aux hommes… Comme le feu lorsqu’il appartenait aux dieux, le pouvoir de nommer semble magique… Mais cette magie est une illusion. Le pouvoir masculin de nommer est maintenu par la force… C’est le fait de nommer par décret qui constitue un pouvoir sur et contre ceux à qui l’on interdit de nommer leur propre expérience.
L’homme ne se contente pas de nommer les femmes mauvaises ; il extermine neuf millions de femmes comme sorcières parce qu’il a nommé les femmes mauvaises. Il ne se contente pas de nommer les femmes faibles ; il mutile le corps féminin… parce qu’il a nommé les femmes faibles… Il la nomme ignorante, puis lui interdit de s’instruire. Il ne lui permet pas d’utiliser son esprit ou son corps de manière rigoureuse, puis la qualifie d’intuitive et d’émotive. Il définit la féminité et lorsqu’elle ne s’y conforme pas, il la qualifie de déviante, de malade, la bat… Si elle le désire sexuellement, il la qualifie de salope ; si elle ne le désire pas, il la viole et dit qu’elle le désire… Il la qualifie de femme au foyer, qui n’est faite que pour la maison… Il la qualifie de tout ce qui lui convient. Il fait ce qu’il veut et l’appelle comme il veut. Il maintient activement le pouvoir de nommer par la force et il justifie la force par le pouvoir de nommer. Le monde lui appartient parce qu’il a nommé tout ce qu’il contient, y compris elle… Le quatrième principe de la suprématie masculine est que les hommes, parce qu’ils existent intellectuellement et créativement, nomment les choses de manière authentique. Tout ce qui contredit ou subvertit la dénomination masculine est diffamé jusqu’à ce qu’il n’existe plus[1].
Ce que Dworkin identifie ici, c’est qu’un mécanisme central du pouvoir masculin sur les femmes réside dans le pouvoir des hommes de nommer — ou de définir — les femmes selon leurs propres termes. En fait, dans sa discussion sur le « premier principe » de la suprématie masculine, Dworkin indique clairement que « le pouvoir des hommes est d’abord une affirmation métaphysique de soi, un “je suis” qui existe a priori… indifférent au déni ou à la contestation », et nous devrions certainement penser ici à l’affirmation des militants trans « Je suis ce que je dis être », et à la question de savoir si cette affirmation tiendrait la route si elle n’était formulée que par des femmes. Le pouvoir masculin réside d’abord dans le fait que les hommes ont une autorité incontestable pour se nommer ou se définir eux-mêmes [c’est l’autodétermination à laquelle nous n’avons toujours pas droit], puis une autorité incontestable pour nommer ou définir les femmes. Ou, comme l’a joliment résumé l’utilisatrice de Twitter The Bewilderness dans sa « 8ème règle de la misogynie » : « Les hommes sont ce que les hommes disent qu’ils sont, et les femmes sont ce que les hommes disent qu’elles sont ».
Cette définition des femmes est étroitement liée à l’analyse de Beauvoir de la « Femme comme Autre », à savoir l’idée que notre société tourne autour d’un sujet masculin par défaut, qui s’attribue toutes les caractéristiques de l’être humain proprement dit tout en ensevelissant les êtres humains féminins sous sa projection patriarcale de la « femme ». Comme l’explique Dworkin, cet acte de projection n’est pas anodin. Il a des effets dévastateurs sur la vie matérielle des femmes. La « femme » est façonnée à partir de ce que Patricia Hill Collins a appelé les « images de contrôle »[2], une collection de fantasmes dénigrants conçus pour discipliner les femmes afin qu’elles se comportent d’une manière qui profite aux hommes. Et c’est ainsi que nous sommes, tour à tour : Madonna, pute, vierge, Lolita, hystérique, mégères, casse-couilles, déesse du logis, allumeuse, Méduse, sirène, crone, féminazi, sorcière.
Ces projections n’ont pas grand-chose à voir, sinon rien à voir, avec la vie des femmes réelles et incarnées : leur rôle est de faire plier les femmes et de les formater pour répondre aux besoins des hommes. Comme le dit Dworkin : « Il lui donne le nom qui l’arrange ». Ce dont il est fondamentalement question avec ce jeu brutal de dénomination, c’est de savoir si les femmes sont considérées comme des êtres à part entière, avec leurs besoins et intérêts propres, et pouvant être disposées ou non envers les besoins des hommes. Comme l’explique clairement Dworkin, citant l’observation lucide de Mary Daly selon laquelle les femmes ont vu leur pouvoir de nommer leur être volé, le pouvoir masculin interdit aux femmes d’affirmer leur droit de nommer et de définir leur propre expérience, et notre existence réelle doit, à tout moment, être soumise à la projection patriarcale de la « femme », c’est-à-dire au service des intérêts masculins. Ce processus par lequel les hommes nomment les femmes en des termes qui servent les besoins masculins est, je dirais, le cœur même du « genre » patriarcal (patriarcal gender).
C’est dans ce sens que Luce Irigaray a affirmé que les femmes n’existent pas réellement dans la culture occidentale. Comme je l’ai souvent mentionné auparavant, lorsque je travaillais sur Irigaray dans le cadre de mon postdoc, j’avais l’habitude de considérer son affirmation de notre « non-existence » comme une métaphore assez pertinente — bien qu’un peu exagérée — sur le fonctionnement du genre patriarcal. Mais c’était avant que l’activisme trans ne croise mon chemin. Le fait que les hommes puissent convaincre une bonne partie de la société du fait qu’ils ont le droit de redéfinir les femmes comme bon leur semble, et que beaucoup de gens ne comprennent même pas que nous ayons le droit de nous y opposer, sans même se rendre compte qu’ils agissent de connivence avec le principe central de la domination masculine, est certainement la plus grande démonstration historique de la vérité de l’affirmation selon laquelle nous vivons dans une culture dans laquelle les femmes réelles en chair et en os n’existent pas vraiment.
Comme Dworkin le souligne ici, cet acte de dé-finition (de-fining) des femmes est en même temps un acte de retraçage — ou d’effacement — des frontières. Nous discutons actuellement des limites du concept de « femme », mais plus foncièrement, des conséquences matérielles réelles de ce concept, des limites des espaces non mixtes pour les femmes, ou de notre droit à délimiter les personnes avec lesquelles nous voulons nous organiser politiquement. Plus fondamentalement encore, ce que nous exprimons lorsque nous parlons de « frontières », c’est l’affirmation de nos besoins ou intérêts spécifiques, et la revendication du respect de ces besoins. Une frontière est tracée lorsqu’une femme dit « non », « je n’aime pas ça » ou « je ne veux pas ». Lorsqu’elle refuse l’abnégation de ses propres besoins ou désir et de se soumettre aux besoins et désirs de celui qui revendique le pouvoir de la nommer. Même s’ils prétendent « détruire la binarité du genre », les militants trans se distinguent par la rage patriarcale dans laquelle ils entrent à chaque fois que les femmes ne se plient pas à leurs exigences. Ils s’obstinent également dans leur incapacité à comprendre que c’est nous — dans le fait de refuser d’être « gentilles » et de les laisser faire — qui sommes ici les véritables transgressistes du genre.
Ce que je souhaite tout particulièrement montrer ce soir, c’est la façon dont l’affirmation des hommes selon laquelle ils seraient réellement des femmes illustre parfaitement les deux facettes du pouvoir masculin de dénomination, si destructeur pour les femmes : il définit les femmes tout en les effaçant en même temps. L’activisme trans consiste à redéfinir les femmes réelles comme la projection patriarcale « Femme » dans la loi et dans la vie publique, accompagnée d’un effort concerté pour effacer tout langage qui lie le concept de femme au concept de « femelle humaine » (female). [Nous parlons de leur tentative de décorrélation du mot femme de la réalité matérielle « femelle adulte de l’espèce humaine » que désigne le terme.] En se définissant comme nous, l’activisme trans met en œuvre l’expression la plus flagrante du lien inextricable entre l’autorité des hommes à se définir eux-mêmes et de leur autorité à nous définir dans le processus. Et ce qui est dévoilé par ce processus, en particulier dans sa capacité à transformer la classe des femmes réelles en une agrégation déshumanisée de parties du corps et de fonctions, c’est qu’au cœur du pouvoir patriarcal de nommer réside l’effacement des femmes par leur soumission à n’importe quelle définition, et de fait, à toutes les perceptions qui conviennent aux intérêts des hommes.
Je ne prétends pas que toute identification trans implique le recours à des projections délétères sur ce que sont les femmes, ni qu’elle implique nécessairement l’effacement de la réalité des personnes de sexe féminin en tant que classe biologique, et la division des femmes en parties du corps. [C’est le cas selon les revendications du militantisme trans.] Mais l’idéologie de l’identité de genre est fondamentalement structurée par ce double geste de redéfinition et d’effacement, et invoque la plupart du temps des stéréotypes patriarcaux si flagrants sur les femmes qu’ils démentent toutes les affirmations manipulatrices d’impuissance et de vulnérabilité du mouvement trans. [L’identité de genre invoque TOUJOURS des stéréotypes sexistes. Il n’y a pas une seule exception à cette règle. L’identité de genre est, par définition, un amas de stéréotypes sexistes.] Ce qui me frappe lorsque je vois, par exemple, un membre masculin de ma profession afficher publiquement des photos de lui en tenue de servante (French Maid), ou Pips Bunce accoutré de dentelles fuchsia qu’aucune femme n’aurait jamais l’idée de porter pour travailler dans une banque [ni même de porter tout court, en fait], c’est l’assurance complaisante que les hommes se verront accorder le pouvoir de définir ce que sont les femmes, aussi caricaturales soient les performances qui en découlent, et que les femmes se verront refuser la moindre autorité pour les remettre en question. [Sales TERF transphobes !]
Comme je l’ai suggéré, cette définition des femmes en tant que projection patriarcale « Femme » a toujours été un acte d’effacement, une manière de nier l’existence et les besoins réels des femmes et de nous transformer en une classe de service ou en une ressource que les hommes peuvent utiliser et s’approprier. Traditionnellement, les ressources que les hommes tentent de s’approprier sont le corps des femmes, dans ses capacités sexuelles et reproductives, et le travail domestique et émotionnel des femmes.
Le militantisme trans se distingue par sa volonté de s’approprier l’image patriarcale de la « femme » [soit le stéréotype misogyne] et d’affirmer la réalité absolue de cette image par rapport à l’existence réelle des femmes, en remplaçant une définition basée sur le sexe par une définition basée sur l’identité de genre [ledit stéréotype misogyne] et en effaçant tout langage reconnaissant que les femmes sont des femelles de l’espèce humaine (females). Cela met en exergue l’effacement de la réalité des femmes en chair et en os, toujours implicite dans la projection patriarcale, tandis que le refus généralisé [manifesté en partie dans les médias] de reconnaître que nous ayons le moindre intérêt légitime à nous définir politiquement, ne rend que plus flagrants l’étendue du pouvoir de nommer masculin dans notre culture et l’acceptation du fait que ce pouvoir n’appartient qu’aux hommes.
Ce que le militantisme trans demande fondamentalement [ce que la conscience patriarcale tout court exige et impose, depuis le néolithique] c’est que les femmes acceptent l’effacement de leur existence intrinsèque devant la projection patriarcale de [l’idée de] « Femme », afin que cette projection soit appropriable par les hommes, pour satisfaire leurs intérêts et leurs désirs. [C’est la définition du « gynovampirisme »].
Ce conflit met non seulement en évidence le pouvoir patriarcal fondamental de nommer, mais il montre aussi le fait que le pouvoir masculin de dénomination met en œuvre l’assujettissement total de la réalité des femmes aux volontés des hommes.
[Elle dénonce le fait que les hommes nomment et déterminent les objets culturels et sociaux, dont les femmes, altérisées et objectifiées, et construisent ainsi la scène sociale en déterminant les rôles et rangs des femmes (et des enfants) en relation à eux-mêmes, les hommes. L’exemple le plus célèbre dans le monde occidental de projection patriarcale érigée au rang de modèle pour toutes les femmes est l’archétype de l’abnégation : la vierge Marie.]
En d’autres mots, il s’agit d’un conflit direct entre le désir des hommes et l’existence des femmes, et il s’avère que nous vivons dans un monde où nous vaquons à nos affaires sans y penser comme si le désir masculin devait toujours l’emporter.
[Les hommes ne font pas que prendre leurs désirs pour des réalités, ils les imposent aux femmes et les font advenir par la force/violence. Et cette violence — ou la menace de — est si bien implantée, insidieusement planante, qu’elle va le plus souvent de soi, étant ainsi imperceptible. Elle est comme l’air que l’on respire et se traduit par les comportements de soumission et de déférence des femmes devant l’entitrement des hommes : l’himpathy envers les agresseurs sexuels, les femmes qui récompensent les hommes de cookies juste parce qu’ils manifestent le minimum syndical de décence humaine (« félicitations, tu t’es abstenu de violer <3 »), les femmes qui s’écartent dans la rue pour laisser passer un homme qui s’attend à juste titre (« entitrement ») à ce qu’elles lui cèdent le passage, les femmes qui accordent de l’attention sur les RS aux commentaires de crétins finis au lieu de se contenter de les traiter comme ce qu’ils sont, les femmes qui laissent parler les hommes ad nauseam dans les groupes sans oser dire « tu nous saoules et ce que tu dis ne sert à rien »… C’est aussi la déférence pavlovienne devant la moindre manifestation de testérie — même lorsqu’elles sont en sécurité physique, par exemple, derrière leur écran. La menace est planante, inodore et invisible, mais elle est là. Le terme « testérie » vient de « testostérone » et désigne l’irrationalité, l’immaturité et l’émotivité violente propres aux hommes des sociétés patriarcales.
C’est aussi ce que traduit la règle grammaticale du « masculin qui l’emporte », et qui conditionne le psychisme des Françaises depuis le 18ème siècle, Françaises dont la « féminité » et « l’élégance » (la soumission aux dictats masculins) sont tant vantées à l’international. Mesdames, autorisez-vous à mépriser quotidiennement ceux qui ne méritent que votre mépris et partez du principe qu’ils ne méritent rien d’autre jusqu’à ce qu’ils fassent leurs preuves.
En effet, la prévalence accordée au désir masculin, inhérente au pouvoir masculin de nommer, est ce qui permet aux hommes de se désigner eux-mêmes « femmes » s’ils le désirent, et à une majorité de personnes de penser que c’est quelque chose de parfaitement raisonnable. L’ironie est que cette priorisation du désir masculin prouve précisément ce que le militantisme trans s’échine à nier : la vérité de l’affirmation féministe selon lequel le pouvoir est, dans cette société, structuré autour des sexes et distribué par sexe. [Plus exactement structuré autour du sexe masculin et distribué aux hommes : c’est la domination masculine.]
Cette dissimulation dramatique de ce qui est en jeu dans le pouvoir patriarcal de dénomination est l’une des principales raisons, je pense, pour lesquelles ce conflit a provoqué le retour de tant de femmes à l’analyse féministe de la deuxième vague sur la domination masculine. Ou, pour emprunter un mot à nos adversaires politiques, pourquoi tant de femmes ont été « radicalisées ». Il est typique de l’hypocrisie des activistes trans, un groupe de personnes qui se considèrent comme des anarchistes anti-système, d’avoir adopté un terme utilisé par l’appareil d’État antiterroriste pour décrire un groupe de femmes qui ne se soumettent pas [aux diktats], comme si les femmes de Mumsnet avaient en quelque sorte subi un lavage de cerveau par les méchantes terves [pluriel humoristique de TERF, soit « terven » en anglais] pour planifier le djihad. Contrairement à ces propos absurdes, ce qu’il faut souligner ici, c’est que les gens se « radicalisent » souvent lorsque les circonstances politiques mettent soudain au grand jour et en toute transparence un mécanisme de domination qui, jusqu’à présent, opérait sous les radars. Et dans un monde qui a longtemps été saturé de faux féminisme amusant qui plaît au patriarcat [« twerkons pour les droits des femmes /L’exploitation sexuelle, c’est du travail, les vrais viols filmés de femmes et la pédopornographie de synthèse sont de la liberté d’expression, etc.] et que Julie Bindel a si bien su démasquer, le militantisme trans a en quelque sorte rendu service au vrai féminisme.
Ce que nous vivons toutes au quotidien en ce moment est une rencontre directe avec le cœur même du pouvoir patriarcal, à savoir le pouvoir masculin de nous nommer et, par ce biais, d’effacer et d’assujettir notre existence aux besoins masculins. Malgré toutes les histoires sur Dieu donnant existence au monde par la dénomination ou Adam revendiquant sa domination sur les animaux en les nommant, le pouvoir masculin de définition n’est pas, comme le note Dworkin, une sorte de magie surnaturelle. Il est plutôt maintenu en place par la force. Et la rencontre directe avec cette force est aussi ce que nous vivons toutes en ce moment. Cette stratégie de mise en œuvre comporte trois moments. Le premier moment est le déni total du droit des femmes à nous définir nous-mêmes, de notre intérêt légitime à notre propre définition, ou de notre droit à contester les définitions qui nous sont imposées. Ce déni — et le pouvoir de ce déni — est invoqué chaque fois que quelqu’un affirme qu’il n’y a pas de conflit de droits ou insiste sur le fait qu’il n’y a « pas de débat » à avoir sur la question de savoir si les femmes doivent être redéfinies contre leur volonté.
Deuxièmement, comme l’indique Dworkin, toute la structure de projection patriarcale sera appliquée aux femmes qui ne se conforment pas à ces projections. Comme elle l’a écrit dans Pornographie : « tout ce qui contredit ou subvertit la dénomination masculine sera diffamé jusqu’à cesser d’exister ». C’est le cœur même du pouvoir patriarcal que le militantisme trans exerce sur les femmes, et c’est là que nous voyons le plus clairement comment les « images de contrôle » des femmes fonctionnent en nous coinçant dans une double contrainte. Le militantisme trans exige que nous nous pliions à une image d’abnégation et à l’idée que, pour reprendre les termes complètement misogynes d’« Andrea » Long Chu, être une femme est « toute opération psychique dans laquelle le moi est sacrifié pour céder la place aux désirs d’un autre[3] ». Cependant, si nous refusons de nous plier à cette « opération » dans laquelle « le moi est évidé, à nos propres dépens », alors toute la panoplie des projections diabolisantes sera déployée contre nous. Le fait qu’un groupe de femmes [d’âge moyen] qui rassemble calmement et méthodiquement des faits et des arguments pour soutenir l’affirmation de leur propre existence et de leurs intérêts politiques puisse être si facilement considérées comme un maelstrom jaillissant de Furies démoniaques, sifflantes et écumantes — ou, si vous préférez, comme des fascistes, des nazis, des suprémacistes blanches, etc. — est l’illustration la plus pure du manuel patriarcal à l’œuvre dans le militantisme trans. Comme le célèbre tweet de J. K. Rowling le résume : « “Feminazi”, “TERF”, “salope”, “sorcière”. Les temps changent. La haine des femmes est éternelle ».
Le dernier moment de cette mise en œuvre patriarcale est la violence — et les menaces de violence — déployée pour contraindre les femmes à accepter la projection patriarcale. Si nous ne pouvons pas être disciplinées en étant diabolisées, nous le serons par la force. La diabolisation sert d’abord à nous contraindre en essayant de nous faire intérioriser les projections, en érodant notre attitude de défi par la honte, mais aussi à justifier la violence exercée contre nous [par les hommes de ces mouvements et leurs servantes]. Comme le note Dworkin : « Il maintient activement le pouvoir de nommer par la force et il justifie la force par le pouvoir de nommer ». Ici, aidées par le catalogue des monstres patriarcaux [Féminazie, TERF, etc.], les limites des femmes ou l’affirmation de nos propres intérêts sont redéfinies sans effort comme du réactionnarisme (bigotry), des préjugés, de la haine, de l’agression et de l’« arsenalisation » (weaponization).
[Ils accusent les femmes d’« arsenaliser leurs traumatismes », entre autres, faisant toujours dans la grande classe. Par exemple, une survivante victime de violences sexuelles qui ne veut pas se retrouver à côté d’un homme hétérosexuel autogynéphile nu, avec son corps de lâche et sa demi-molle, dans les douches d’un refuge pour femme sera accusée par celui-ci de transphobe qui essaie d’« arsenaliser ses traumas pour légitimer sa « transphobie ».]
Et les menaces extrêmes, souvent ouvertement sexualisées [« étouffe-toi avec ma grosse bite de femme »], mises en œuvre pour forcer nos limites sont alors, à l’inverse, redéfinies comme un acte d’autodéfense légitime et justifié. Comme de nombreuses personnes l’ont observé, ce qui se passe en ce moment révèle le fonctionnement de la violence masculine en tant qu’elle est une caractéristique structurelle [intrinsèque], et non accidentelle, d’une société suprématiste masculine, qui contraint les limites des femmes et les force à se conformer à l’abnégation pour servir les objectifs des hommes.
Grosso modo, tout ce mécanisme — les hommes définissant les femmes selon leurs propres termes, exigeant des femmes qu’elles s’effacent pour répondre aux besoins des hommes, niant que les femmes aient le droit de s’opposer, niant que les femmes aient un droit à consentir [ou non], diabolisant les femmes qui ne consentent pas et essayant de forcer leur consentement en les diabolisant et en les menaçant de violence — c’est là toute la logique d’une culture du viol suprématiste et masculine dans son ensemble. Pour revenir au sous-titre de Pornographie de Dworkin — les hommes s’approprient les femmes — ce contre quoi nous faisons face, avec le militantisme trans, c’est l’ensemble du mécanisme dominant de la logique du viol qui s’abat sur les femmes, non pas au service des hommes qui se servent du corps des femmes pour leur propre plaisir, mais au service de l’accomplissement de l’effacement absolu de « l’être incarné des femmes » qui a toujours été le moteur de la projection patriarcale, dans le but de satisfaire leurs désirs en s’appropriant cette projection en tant que réalité.
[La conscience patriarcale « trans » est un dualisme métaphysique sous amphétamines].
Loin d’être un défi aux mécanismes du genre patriarcal, le militantisme trans est la plus grande mise en œuvre de la logique de viol coercitif, de la part d’une société suprématiste masculine, qu’il m’ait été donné de voir de mon vivant.
Dans ce contexte, il est évident, je l’espère, que ce qui pourrait sembler pour certains [ceux qui ne sont pas menacés] n’être qu’un conflit insignifiant autour d’un mot va en réalité beaucoup plus loin que cela. La définition de la femme en tant que « femelle humaine adulte » délimite notre existence en tant que classe de sexe, définit les limites de nos espaces, de notre droit aux ressources, de notre capacité à nous organiser politiquement et à parler de notre propre oppression, de la légitimité de nos intérêts politiques et de notre capacité à rejeter la projection anéantissante (abnegating) de la « femme » en tant que classe complaisante d’humains de soutien serviles construits pour répondre aux besoins des hommes. [C’est ainsi que sont figurées les femmes dans les mythologies grecques patriarcales et chrétiennes, construites pour servir l’homme et à la fois pour le punir, en tant que créatures intrinsèquement mauvaises, malsaines et inférieures]. Lorsque nous nous battons pour ce mot — lorsque nous nous servons de nos mots pour définir les limites de notre consentement — nous faisons, en soi, quelque chose qui a des conséquences très réelles et très matérielles sur la vie des femmes. Nous résistons à la logique dominatrice de viol d’une culture suprématiste masculine qui détruirait joyeusement l’existence des femmes humaines de chair et d’os pour s’approprier tout ce qu’elle désire de nous, pour sa propre satisfaction.
[Ne souhaitant pas travestir ses mots dans le corps du texte, je propose une reformulation qui nomme les agents réels de la violence : « Nous résistons à la logique dominatrice de viol d’une culture suprématiste d’hommes qui détruiraient joyeusement l’existence des femmes humaines de chair et d’os pour s’approprier tout ce qu’ils désirent de nous, pour leur propre satisfaction (bien souvent sexuelle) ».]
Il est donc impératif que les femmes se réunissent sur le champ pour tracer et redessiner les frontières autour de nos mots, de nos espaces, de nos besoins, de notre existence même, et de tracer encore et encore.
Il faut le répéter :
Nous existons.
Nous sommes des femelles humaines adultes.
Nous ne sommes pas vos projections.
Nous refusons votre droit de nous nommer.
Nous défierons votre diabolisation et votre coercition.
« Non » signifie « non ».
[1] Pornographie : les hommes s’approprient les femmes (Andrea Dworkin) https://www.editionslibre.org/produit/pornographie-les-hommes-sapproprient-les-femmes-andrea-dworkin/
[2] Feminist Thought (Londres et New York : Routledge, 2000). Collins s’intéresse ici à la manière dont les « images contrôlantes » des femmes noires fonctionnent pour les réduire à l’état d’objet et permettre leur exploitation. Son analyse se situe toutefois dans le cadre d’une compréhension de la fonction d’« altérisation » (othering) de la hiérarchie binaire, qui est en accord avec mon argumentation.
[3] Andrea Long Chu, Females (London: Verso, 2019), p. 11. 154 L’auteur a été récompensé cette année du prix Pulitzer.